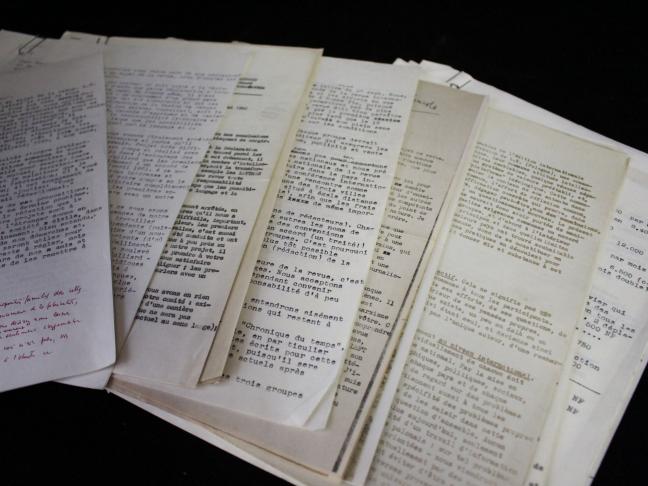
Des milliers de manuscrits passent entre leurs mains. Souvent surdiplômés, sous-payés, les lecteurs accomplissent une tâche essentielle, mais parfois ingrate, dans le processus de publication.
Article de Nicole Vulser publié dans Le Monde Économie le 17 mars 2018.
Chaque jour, trente à quarante manuscrits arrivent par la poste chez Gallimard. Leurs auteurs, jusqu’à 8 000 par an, espèrent être publiés dans la collection « Blanche », le nec plus ultra de l’édition. Des montagnes de projets de romans enveloppés dans du papier kraft se reforment quotidiennement. La personne chargée du tri lit en diagonale tout ce qui arrive dans la journée. Secoue les manuscrits pour en faire tomber une fleur séchée ou un ticket de métro et éviter d’être accusée de ne pas avoir lu l’œuvre de A à Z. Il s’agit d’effectuer à vive allure une sélection entre les ouvrages qui ne sont pas aboutis, ceux qui ne correspondent pas à la maison, les très mauvais, les moyens et les rares excellents.
Environ 10 % à 15 % des manuscrits filtrés par ce premier tamis seront confiés à des lecteurs. Une armada de professionnels, dont le travail consiste à lire pour les grands éditeurs une masse de manuscrits pour ne conserver que ce qui pourra être publié. « J’ai trouvé des pépites formidables », raconte Ludovic Escande, lecteur et éditeur chez Gallimard. « C’est au courrier qu’ont été découverts les romans de Tristan Garcia, Aurélien Bellanger, David Foenkinos ou Joy Sorman… et même L’Art français de la guerre, le premier roman d’Alexis Jenni, le Goncourt de 2011. »
Le salon Livre Paris, qui se tient jusqu’au 19 mars, permet un coup de projecteur sur ces lecteurs sous-payés, qui jouent, dans l’ombre, un rôle essentiel dans le processus de publication. Lire un manuscrit, en rédiger un résumé et une fiche argumentée sur l’intérêt ou non de le publier n’est rémunéré qu’entre 30 et 60 euros, selon le nombre de pages. Seuls les 640 lecteurs du Centre national du livre (CNL) perçoivent jusqu’à 150 euros pour expertiser chaque année, dans le cadre des aides à la traduction, près de 2 500 ouvrages en langue originale et en français. Impossible de vivre de cette activité, même pour les lecteurs les plus compulsifs.
Très rarement salariés
Qui sont-ils ? Il y a parmi eux des étudiants en littérature, des auteurs eux-mêmes, des chercheurs, des enseignants, des libraires. Parfois des comédiens. Même un maçon. Des passionnés de lettres, toujours. La mère de Vincent Bolloré, Monique, amie de Claude, le père d’Antoine Gallimard, actuel PDG des éditions Gallimard, fut une lectrice assidue pour la collection « Folio » (Gallimard) pendant plus de quarante ans. Les lecteurs sont presque toujours extérieurs aux maisons d’édition. Très rarement salariés, donc. Aucun syndicat ne les fédère, ne les défend ni ne les recense : le Syndicat national de l’édition estime leur nombre à 233, en 2017, dans les 35 grandes maisons d’édition. Avec les 640 lecteurs du CNL, la profession regroupe probablement un petit millier de personnes. Autoentrepreneurs ou travailleurs à domicile, ils sont payés en honoraires, en piges et parfois, ce qui n’est pas légal, en droits d’auteurs.
« J’aime lire au lit, c’est un job idéal »,explique Julia Kerninon, qui a déjà publié trois romans aux éditions du Rouergue et dévore une vingtaine de manuscrits par mois pour cette filiale d’Actes Sud et aussi pour Kero (Calmann-Lévy). « J’élimine vite ce qui n’a aucune chance de faire un livre. Les autofictions, les amas chaotiques de remarques personnelles et là où la grammaire est trop déficiente »,explique cette docteure en littérature américaine, installée à Nantes. « En revanche, je fais remonter tout ce qui peut être publié. » Elle sélectionne peu ou prou quatre livres sur vingt. Comme celui de Ludovic Robin, qui avait envoyé « un beau texte à la Jim Harrison », Aller en paix (Editions du Rouergue, 2017).
Pour Séverine Meyer, libraire à Grenoble, être lectrice pour Actes Sud constitue un « petit boulot d’appoint »depuis une vingtaine d’années. « C’est affreusement mal payé », concède-t-elle. Certaines maisons lui ont même proposé de la payer en lui offrant des livres. Sans surprise, sa réponse a été négative… « Ce n’est pas un travail considéré dans l’édition », observe-t-elle. De plus, le taux de publication des manuscrits reste « très, très faible ». Tout n’est pas palpitant. « Je lis peut-être une fois par an un manuscrit dans lequel il n’y a rien à changer », souligne la lectrice. Aux habitués d’Actes Sud déjà publiés, elle « explique, par exemple, pourquoi, page 92, le dialogue ne fonctionne pas ».
« Environ 2 % de ce qui arrive par le courrier est publié »
Une tâche parfois ingrate. Antoine Gallimard raconte qu’un des lecteurs de la maison, l’un des rares payés au mois, « a lu pendant dix ans pour nous, sans que jamais l’un des manuscrits qu’il avait eu entre les mains soit publié. Découragé, il a arrêté, a écrit un livre que nous avons publié, mais n’a pas fait une vente… »L’infortuné a quitté Paris pour recommencer sa vie aux Etats-Unis.
« Si dans le premier tri, il est possible de lire quelques pages, du début, du milieu et de la fin, les lecteurs, eux, lisent les manuscrits in extenso »,rappelle Anna Pavlowitch, directrice du pôle littérature générale chez Flammarion. « Environ 2 % de ce qui arrive par le courrier est publié », dit-elle. Un pourcentage presque haut dans la profession. Flammarion fait régulièrement appel à trois ou quatre professionnels qui lisent souvent les mêmes manuscrits que leurs confrères, puisque les auteurs envoient d’emblée leur prose à cinq ou six éditeurs. D’où cette urgence à lire pour éviter de passer à côté de « la » perle et la voir publiée chez un concurrent.
Les lecteurs, souvent bardés de diplômés et surqualifiés, aspirent à d’autres destinées. Normalienne et agrégée de lettres, Sylvie Taussig, qui vit au Pérou, a bénéficié d’un contrat de cadre pendant vingt-huit ans chez Robert Laffont. « Je lisais pour eux six livres par semaine – en plusieurs langues – en rédigeant des notes de lecture et en gagnant 1 000 euros par mois. Je n’ai pas touché un centime de congé de maternité, j’ai été confrontée à des problèmes insolubles vis-à-vis de la Sécurité sociale. Sans jamais être aidée. J’ai fait une dépression », raconte-t-elle, pour tout « bilan de 28 années d’esclavage ». Elle continue de travailler pour Albin Michel, davantage pour réécrire, arranger ou traduire des textes de sciences humaines. Apprendre des milliers de choses et « pas seulement cracher de la note de lecture », dit-elle, un peu amère.
Un lecteur polyvalent
Les éditeurs travaillent chacun à leur manière avec les lecteurs. Certains utilisent comme botte secrète un lecteur polyvalent, auquel ils demandent de lire confidentiellement plusieurs versions retravaillées d’un même texte. Pour vérifier le travail d’un éditeur ou tenter d’améliorer le roman d’un auteur vedette… D’autres renoncent à utiliser des lecteurs et préfèrent repérer les auteurs qui marchent en autoédition sur Internet pour les convaincre de les rejoindre.
Pour sa part, Sophie de Closets, PDG de Fayard, met un point d’honneur à lire les manuscrits envoyés à son nom. Même un pavé de 800 pages sur l’art du revers au tennis ou un énième récit de voyage familial en camping-car en Patagonie. « J’ai du mal à croire qu’il existe des trous béants dans la raquette et que tous les éditeurs passent à côté d’un génie », assure Sophie de Closets.
Paul Otchakovsky-Laurens (P.O.L), disparu en janvier, était l’un des rares à lire les 3 000 manuscrits qui arrivaient par la poste. Il se réservait le plaisir de les ouvrir un à un. « Ce sont mes choix, je ne m’intéresse qu’à ce qui me plaît », disait-il.
Gallimard a porté à son paroxysme l’organisation de son système de lecteurs. A un premier cercle de dix lecteurs s’ajoute un second cercle d’une douzaine de membres, habilité à siéger une fois par mois au comité de lecture. « Il n’y a pas non plus de numerus clausus », précise Antoine Gallimard. Ce comité regroupe des auteurs maison comme Jean-Marie Laclavetine, Maylis de Kerangal, Maud Simonnot, Christine Jordis, Nathacha Appanah, mais aussi des éditeurs maison et le secrétaire général du comité, Philippe Demanet.
« Je ne suis pas l’arbitre des belles harmonies. Je ne cherche pas le consensus », affirme Antoine Gallimard. « Le comité de lecture doit rester un lieu de vives discussions. Si un éditeur lecteur est enthousiaste pour un livre, on le prend », assure-t-il. Sur de petites fiches cartonnées au logo de la Nouvelle revue française (NRF), les mêmes depuis 70 ans, chacun a écrit son résumé et son commentaire. Et donné sa note, de 1 à 3. « Le 1, c’est bien, la note absolue. 1,5 : à publier, mais on demande une seconde lecture. 2 : à écarter, mais mérite un certain intérêt. Et 3 : il faut changer de trottoir si l’on rencontre l’auteur », détaille le PDG de Gallimard.
Enfin, l’histoire apprend à être modeste. En décembre 1912, Jean Schlumberger, de la NRF – suivi par trois autres lecteurs – avait balayé Marcel Proust d’un « c’est plein de duchesses, ce n’est pas pour nous ! »,refusant le manuscrit d’A la Recherche du temps perdu. C’est finalement André Gide qui avait fait son mea culpa, au nom de la NRF, auprès de l’écrivain après la publication à compte d’auteur de son œuvre magistrale chez Grasset…
Article de Nicole Vulser publié dans Le Monde Économie le 17 mars 2018.