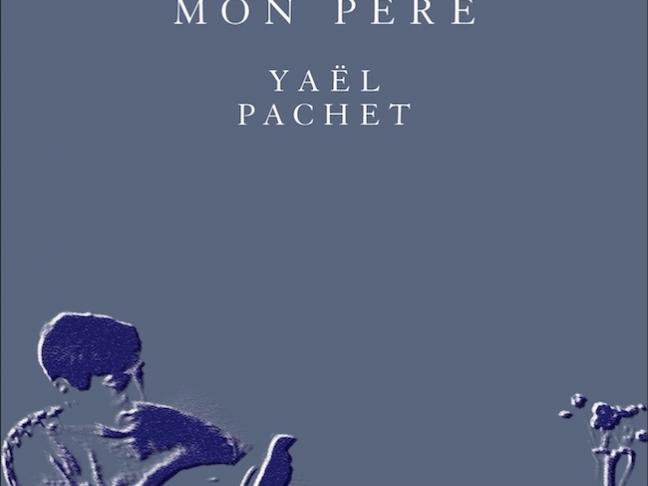
Avec Le Peuple de mon père, Yaël Pachet évoque l’écrivain Pierre Pachet, disparu en 2016. À la fois journal de deuil, au plus juste des émotions et des sentiments, et fresque identitaire et familiale. Un livre intime et lumineux. Lecture de Jean-François Sabourin.
Yaël Pachet est née à Orléans, le 24 janvier 1968. Fille de l'écrivain Pierre Pachet, elle a publié des textes littéraires dans diverses revues et également assuré la critique de parutions musicales. Elle continue de contribuer régulièrement à la Nouvelle Quinzaine littéraire. En 2005, cette auteure a publié Ce que je n’entends pas aux éditions Aden.
À l’origine, Yaël Pachet voulait écrire sur sa mère, morte en 1999. “Je la trouvais plus romanesque, plus mystérieuse. Elle était prof de français et nourrissait une passion pour Sinbad le marin qui, comme elle, n’a eu de cesse de repartir vers l’inconnu”, écrit-elle. Elle abandonne l’idée mais écrit sur son père, auteur entre autres de En attendant Nadeau et décédé en 2016, chez lui, dans son appartement à Paris. “J’ai toujours sacralisé mon père, sans vergogne, avec l’acharnement du disciple, avec la bêtise de Cléanthe, parce qu’il y avait un sacré, non pas en lui, mais auquel il donnait accès, un au-delà de lui qui aspirait mon attention et la soufflait plus loin”. L’auteure y consacre aussi de belles pages à sa mère, Soizic, l’élégante épouse bretonne, elle aussi sujet désirant, auprès de qui son père est enterré, et qui n’était pas juive. Soizic ou la part chrétienne du ménage. “Elle avançait parmi nous comme une femme qui vient d’ailleurs et recrée sans cesse pour nous, dévouement inouï, l’ici et maintenant, alors qu’elle-même n’a cessé de se sentir une étrangère dans sa propre famille”.
On entre parfois dans les livres qui relatent le deuil d’un être cher avec un sentiment d’indiscrétion. Une part très privée y est dévoilée dont on devient comme le voyeur. Avec le livre bouleversant de Yaël Pachet, le sentiment est exactement inverse. On est invité, bienvenu, dans un large espace de relation et d’amitié, comme le suggère le si beau titre de l’ouvrage. “Entrer dans le monde des souvenirs de ses parents, écrit-elle, c’est retourner la terre encore plus profondément”.
À la fois journal de deuil, au plus juste des émotions et des sentiments, et fresque identitaire et familiale. Le roman de Yaël Pachet retrace ainsi la vie de Pierre, fils de Simkha, juif d’Odessa arrivé en France avant la première guerre mondiale, et de Ginda, originaire de Lituanie, tous deux porteurs d’une “mémoire en souffrance”. La fille de l’écrivain mesure, après la mort de son père, l’étendue de ce qu’il lui a transmis en lui léguant le goût des livres, de l’écriture et de la vie intérieure, ce kaddish sans retenue, cette prière des morts chuchotée au chevet d’un mort aimé. Mue par l’adoration qu’elle lui vouait mais aussi l’impérieuse nécessité de l’écriture qui avait irrigué la vie de son père, Yaël Pachet lui consacre ici un livre intime et lumineux.
“Il faut écrire. Jamais mon père n’en formulait aussi clairement l’injonction, mais c’était ce que je ressentais à ses côtés. Il me demandait toujours si j’étais en train d’écrire comme on prend des nouvelles d’un proche: Tu t’ennuies ? Tu n’as qu’à avoir une vie intérieure ! Alors tu ne t’ennuieras jamais…”
Sous la plume de sa fille se dessinent les traits d’un homme intense, à la fois heureux et anxieux, bougon et attentif, austère et prodigieusement vivant, écartelé entre une “disponibilité à l’égarement, à la distraction” et une “exigence de vérité, une conscience inquiète du réel”. Elle dit la force et la plénitude, l’autorité et le charme, l’allure. En filigrane du récit, Yaël Pachet livre des sensations et des images, fragments épars d’un quotidien enfui : le bruit des mules de son père quand elles frottaient le parquet, la manière singulière qu’il avait de s’asseoir sur une chaise, de s’y tenir au bord, dans un déséquilibre constant, les cigarettes fumées en silence sur le balcon quand il venait la voir à Nantes.
“En réalité, ce n’est pas tellement ce qu’il dit, mais c’est ce qu’on ressent à ses côtés, écrit-elle. Lui-même reste pourtant réticent à se dire écrivain, intimidé ou agacé par une certaine posture que les écrivains prennent en société. S’il doit se tendre et se dresser, c’est pour les femmes qu’il aime plus que les hommes.”
Pour l’auteure, dans les livres de son père, il s’agissait aussi, parfois, simplement, de se laisser aspirer par les bouches avides de la nuit, du sommeil. Celui-ci cherchait peut-être au fond à trouver une alliance entre un laisser-être, une disponibilité à l’égarement, à la distraction, et une exigence de vérité, une conscience inquiète du réel. Cette alliance de vigilance et de décontraction est un crépuscule qui introduit aussi bien la nuit que le jour. Sa fille, Yaël, depuis, écrit ce crépuscule.
“Ce livre est le meilleur moyen d’y parvenir, confie-t-elle. Il me permet de continuer à parler sans son écoute, pour être sûre que j’entends encore ma propre voix. Car à sa mort je me suis sentie menacée par une sorte de silence.”
Le Peuple de mon père, de Yaël Pachet, 270 p., 18 €, ISBN: 978-2-213-71251-2.
